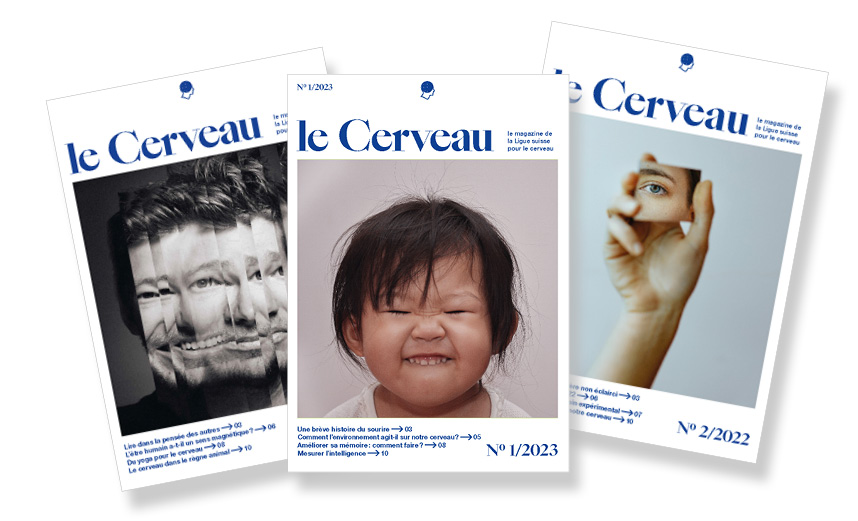Le jour de son 38e anniversaire, le philosophe français Michel de Montaigne opéra une coupure radicale. Il mit fin à sa charge de conseiller au Parlement de Bordeaux et se retira dans sa bibliothèque privée, où il passa le reste de sa vie à écrire ses essais sur l’objet complexe, insaisissable et versatile qui faisait toute sa fascination: lui-même.
Une folle entreprise allait-il bientôt constater, car, ne cessant de changer, sa personnalité se dérobait à une description qui ne fût empreinte d’ambigüité. Mais il en aurait fallu davantage pour l’empêcher de poursuivre ses recherches, de poser des questions et de chercher des réponses. Depuis lors, des générations de penseurs se sont penchées sur la question de savoir comment on devient ce que l’on est. La personnalité est-elle déterminée par l’environnement; quel rôle jouent les gènes? Notre époque ne conçoit plus l’hérédité et l’environnement comme des pôles contraires, mais comme les parties d’un tout.
Qu’est-ce que la personnalité ?
Qui dit personnalité, dit deux sortes de choses: le tempérament et le caractère. En grande partie inné et demeurant relativement stable tout au long de la vie, le tempérament se manifeste par des réactions émotionnelles. Façonné par des influences culturelles et nos expériences personnelles, le caractère évolue au cours de l’existence.
La personnalité de l’homme peut être définie à l’aide de cinq traits centraux, les « Big Five », mis en évidence entre 18 000 caractéristiques possibles par une étude internationale. Ce sont l’extraversion (tendance à rechercher la compagnie des autres), l’ouverture à l’expérience (curiosité et intérêt pour la nouveauté), l’agréabilité (tendance à se montrer coopératif), le caractère consciencieux (exactitude, fiabilité) et la stabilité émotionnelle (équilibre, décontraction). Comment ces propriétés se répartissent-elles sur les différentes tranches d’âge ? Les traits de caractère changent-ils au cours de la vie ou restent-ils stables ?
Le caractère consciencieux augmente vers la quarantaine...
La chercheuse allemande Jule Specht et son équipe ont étudié sur une durée de quatre ans les traits de personnalité de 15 000 individus de 16 à 82 ans. Celui pour lequel les différences entre les groupes d’âge sont le plus marquées est le caractère consciencieux. Les jeunes adultes ont généralement tendance à être plutôt imprévoyants et peu structurés. Cela semble toutefois changer jusque vers la quarantaine et augmenter très fortement entre 20 et 40 ans. L’agréabilité paraît, elle aussi, devenir plus marquée avec le temps, mais à un âge plus avancé, au-delà de 60 ans. L’ouverture à l’expérience, en revanche, baisse avec les années: les participants plus âgés manifestaient généralement un intérêt moins vif pour l’art moderne ou l’innovation technologique. Quant à la stabilité émotionnelle et l’extraversion, elles sont d’un niveau à peu près égal à tous les âges.
...et décroît passé l’âge de la retraite
Quelle influence ont sur la personnalité des événements tels que l’entrée dans la vie professionnelle ou le départ à la retraite ? On note à cet égard un effet intéressant. Les données analysées par Jule Specht montrent que le caractère consciencieux, généralement en forte augmentation après l’entrée dans la vie professionnelle, retombe à partir de l’âge de la retraite. « L’activité professionnelle renforce très manifestement la tendance à agir avec réflexion et à prendre sa part du travail. Lorsque, l’âge de la retraite venu, cette obligation d’un seul coup disparaît, la personne n’a plus envers soi la même exigence. Les psychologues parlent à ce propos d’effet «dolce vita», explique Jule Specht.
L’influence des gènes
Et les gènes ? Quel rôle jouent-ils ? C’est sur l’extraversion et la stabilité émotionnelle que l’action des gènes est la plus nette. On note un effet similaire pour le conservatisme, le contraire de l’ouverture à de nouvelles expériences. Quant à la religiosité et à l’engagement au service de l’Eglise, ils semblent surtout être conditionnés par les facteurs environnementaux. Aucune influence génétique notable n’a été mise en évidence pour l’attitude vis-à-vis des étrangers ou des personnes appartenant à d’autres ethnies. « La synthèse des différentes recherches ayant pour objet les jumeaux montre que les gènes peuvent avoir sur la personnalité une influence considérable. Il n’empêche, comme l’explique le spécialiste des neurosciences Norbert Herschkowitz, que les facteurs environnementaux peuvent néanmoins être déterminants. »